Fatboy Slim aux Transmusicales de Rennes 98 – Slim frasques
02/12/1998
Ce sera l’événement de ces vingtièmes Transmusicales : samedi soir, les platines mythiques de Fatboy Slim toucheront pour la première fois le sol français. Un sol soudain instable et glissant, bombardé par la furie bacchanale de ce DJ entonnoir, le plus puissant antidépresseur de l’époque. Des Housemartins à la house tout court, de Freakpower au pouvoir, le parcours en montagnes russes d’un survivant.
C’était une maison blanche, accrochée à la colline. On y venait à pied, on ne frappait pas, ceux qui vivaient là avaient jeté la clé. Enlacés roulant dans l’herbe, on écoutait Fatboy Slim aux platines, les Chemical Brothers à la sono, jusqu’à la nuit noire. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous. Ce pavillon Sam suffit où Norman Cook avait installé sa communauté et ses disques possédait un nom hospitalier : The House of Love.
C’est ici, dans la plus grande permissivité, que s’est déroulée, week-end après week-end, la plus sexy des partouzes qu’a connues la musique anglaise récente. Ici que fut prononcé pour la première fois le mot historique : big-beat. Une conception festive et euphorisante de la musique de danse conçue dans cette Maison de l’Amour mais élevée un peu plus bas, sur le front de mer, au Concorde : un club miteux mais mythique.
Avant de devenir un pré carré aussi piétiné et clôturé que les autres, un style codé parqué dans des compilations ternes, le big-beat fut en effet, loin des modes, la bande- son d’une aventure hédoniste et paillarde : la Big Beat Boutique, détonante terre d’expérimentation à chaud (la condensation faisait pleuvoir à l’intérieur du club). Victime de son succès, le club où Fatboy Slim et ses copains de la Maison de l’Amour mirent le feu aux barrières, bombardèrent les postes-frontières entre genres chaque vendredi soir, a déménagé pour le cadre clinquant de The Beach, un club du front de mer, perdant au passage son prénom. La Big Beat Boutique est désormais la Boutique, une institution plutôt pépère et touristique où se cultive la nostalgie des débauches d’antan, quand Brighton pogotait férocement loin des projecteurs de la mode, dans une permissivité inégalée : même l’album On the floor at The Boutique, où Fatboy Slim exposait son programme électoral il y a quelques mois, ne parvient pas à faire souffler cet authentique vent de folie qui secouait le vieux Concorde, qui se fissurait littéralement sous les explosions de félicité provoquées par Smells like teen spirit de Nirvana ou All day & all night des Kinks, Give me my auger back de Psychedeliasmith ou le Deaf Mick’s throwdown des Clockwork Voodoo Freaks.
Signe des temps, Norman Cook a lui aussi déménagé. En quelques remixes astucieusement sélectionnés d’INXS aux Beastie Boys, avec une facture de 150 000 f pièce pour ce supplément de crédibilité et en un tube incontestable l’été dernier, Rockafeller skank, Norman Cook a changé de quartier, abandonnant la Maison de l’Amour et sa décoration graffitis, portraits de Smilies à une famille qui ignorera tout des ribouldingues dont elle fut le témoin. Des collines sans éclat de Preston Park, il est parti pour ce que les locaux appellent Millionaire Row (l’impasse des milliardaires), une enfilade de maisons kitsch qui tournent le dos à la zone industrielle du port de Shoreham pour ne regarder que vers le sud, vers l’océan. Des maisons sans signes extérieurs de richesse, mais dont les noms sur les boîtes aux lettres quelques stars britanniques de la télévision et du cinéma en disent long sur ce que cachent ces murs blancs.
Et, effectivement, l’immense maison de Norman Cook rend ivre de jalousie, paquebot de béton posé à même les galets, son studio d’enregistrement lorgnant joyeusement sur la plage privée. Cas rare dans le rock : jamais on n’a entendu Norman Cook afficher d’état d’âme. Cet ado de 36 ans accepte ce luxe les yeux écarquillés, bénissant chaque minute ce jour où les Chemical Brothers, de passage dans sa Maison de l’Amour, l’entendirent pour la première fois mixer, poussant ce paresseux doublé d’un timide à enregistrer son premier album, Better living through chemistry.
Norman Cook revient de loin et s’en souvient, lui qu’une dépression carabinée et des abus chimiques transformeront, au début des années 90, en pâle légume. Abandonné par sa femme et sa confiance, mais vaniteux et ambitieux jusqu’au détestable, Norman Cook acceptera alors tout et n’importe quoi, remixera Vanessa Paradis comme il composera la musique d’un jeu vidéo des Schtroumpfs. Norman Cook s’en fiche : ce n’est pas lui qui s’y colle. Car l’homme que l’on avait appris à connaître, volubile, derrière la basse des Housemartins, n’existe plus. Pour chaque boulot, il envoie ses dopplegangers, change de pseudo chaque mois : on le reconnaîtra ainsi derrière Freakpower, Beats International, The Mighty Dubkatz, Fried Funk Food ou Pizzaman… Mais c’est sous les traits de Fatboy Slim qu’il retrouvera le sourire : DJ aphrodisiaque de la Big Beat Boutique, il enregistrera d’abord Better living through chemistry, féroces chansons de joie décérébrée qui feront de lui l’ambassadeur mondial de cette fièvre, le visage d’un style réputé pour l’effacement de ses auteurs qui, franchement, voudrait être ami avec ces ballots de Chemical Brothers ?
Cet été, il officialisera même sa situation de leader omnipotent en signant l’hymne du genre : Rockafeller skank, le tube mondial derrière lequel couraient toujours ses copains Wiseguys, Propellerheads, Monkey Mafia ou Death In Vegas. Décidément content d’avoir rencontré Fatboy Slim, Norman Cook lui a même donné un second album, le justement titré You’ve come a long way, baby : le disque d’un survivant. Mais le titre aurait dû être la phrase écrite sur le T-shirt du gamin obèse de la pochette : “I’m #1, so why try harder “ Une phrase qui résume parfaitement la situation du Brightonien : traduite “Je suis numéro un, pourquoi vous fatiguer ?”, elle renvoie effectivement la concurrence à ses recherches, incapable de suivre la cadence de ces Gangster trippin’, ces Praise you absolument parfaits ici et maintenant… Traduite “Je suis numéro un, pourquoi me fatiguer ?”, elle s’amuse de la paresse palpable de Fatboy Slim, dont beaucoup d’idées demeurent ici inachevées, parfois même bâclées par quelques ficelles.
Aussi doué que couleuvre, Fatboy Slim voulait d’ailleurs baptiser son album d’un autre titre : Viva la underachiever. Soit, à peu près : “Vive le sous-régime, vive la contre-performance”. Une indolence qu’il réserve à ses disques : redevenu DJ, Fatboy Slim ne connaît plus alors que la performance, le sur-régime. Un régime Slim et fast(ueux), qui fait perdre inhibitions et kilos superflus.
De tous les artistes techno, tu es sans doute celui qui est le mieux accepté par les fans de rock. Comment l’expliques-tu ?
Norman Cook Ce pont entre rock et dance, je ne l’emprunte pas, je ne lui fais pas confiance. La musique des Happy Mondays ou même celle de mes copains de Lo-Fidelity Allstars ne m’intéresse pas. Si le public rock m’a adopté, c’est sans doute parce qu’il me connaissait à l’époque où j’étais bassiste des Housemartins, il s’imagine qu’il existe une solidarité indie-rock entre nous. Alors que moi, j’ai toujours détesté cette musique, je haïssais les groupes dont on nous rapprochait, comme les Smiths. Et puis, à la base, je suis un musicien : c’est rassurant, les gens savent que je joue de la basse, quelques notes… Je ne suis pas un de ces DJ qui ne connaissent que les rythmes.
Avais-tu l’impression d’enfoncer des portes autrefois fermées en enregistrant ton premier album, Better living through chemistry ?
Je n’aurais jamais envisagé qu’il devienne important. D’ailleurs, à sa sortie, il est passé plutôt inaperçu. Je venais de recommencer à faire le DJ et il me manquait des disques à passer : j’ai donc écrit quelques chansons pour mon set, qui sont devenues cet album. Ce sont les Chemical Brothers qui m’ont poussé à faire ce disque, en m’invitant derrière les platines de leur club londonien, le Heavenly Social. Ils étaient convaincus que j’étais un bon DJ car ils avaient entendu parler de ma collection de disques. Mais très vite, je me suis rendu compte que je passais toujours les mêmes titres les Chemical Brothers ou Monkey Mafia , j’étais même obligé de passer des maxis de trip-hop en 45t pour meubler mes deux heures. Ça explique le côté très rentre-dedans et braillard de ce premier album, uniquement pensé pour le dance-floor.
Pourquoi avais-tu arrêté toute activité de DJ, jusqu’à ce que les Chemical Brothers te rappellent ?
Pas assez de temps et de graves problèmes de stress. Et aussi parce que, petit à petit, je me suis retrouvé seul, abandonné par tous mes amis, que je ne pouvais plus voir, eux qui dormaient pendant que je travaillais et vice versa. J’ai préféré revenir à une activité plus normale : bassiste. J’ai donc tourné avec Freakpower, mais sans conviction. Je suis meilleur derrière mes platines que derrière une basse. Alors il m’a fallu faire des choix : être un DJ, un artiste et un remixeur, ça suffit pour un seul homme. J’ai abandonné mon groupe, même si ça me manque parfois.
Pour maintenir cette illusion de gang, je voyage systématiquement avec ma garde rapprochée de la Big Beat Boutique. Un gang de deux personnes (rires)… Sauter en l’air sur le dernier morceau, les rappels, c’est un plaisir que je ne fréquente plus. Mais d’un autre côté, être leader d’un groupe, c’est comme être directeur d’une entreprise : les musiciens passaient leur vie à maugréer, à me réclamer de l’argent… Ça condamne au succès, car il faut en permanence faire vivre dix personnes. Il y a deux ans, j’ai tout liquidé, je n’en pouvais plus. Aujourd’hui, je me contente de prendre l’avion avec ma valise de disques, je n’ai plus à faire l’appel chaque matin pour être certain que tout le monde est dans le bus.
Better living through chemistry a été énormément copié. Le prends-tu comme un honneur ?
Je dois être honnête : c’est moi qui ai commencé à copier, en pillant les idées de Monkey Mafia ou des Chemical Brothers. Idem pour la Big Beat Boutique : nous nous sommes contentés d’importer à Brighton les idées du Heavenly Social de Londres. Moi, je n’entends jamais mon influence chez les autres. Et puis, je ne vais pas cracher dans la soupe et commencer à me plaindre que le big-beat est partout aujourd’hui, ce serait gonflé de ma part. Ce qui serait insupportable, ce serait une domination sans partage du genre, que les autres ne puissent pas trouver de boulot. Ça a été mon cas pendant des années, alors que l’Angleterre était sous la dictature de la house, et j’en ai beaucoup souffert. Les maisons de disques ne voulaient que des maxis de house, jusqu’à ce que Prodigy leur prouve qu’on pouvait aussi faire des albums de dance-music. J’étais en fait assez opposé à la house au début, il m’a fallu des mois pour y venir. Aujourd’hui encore, je ne supporte pas les clubs qui ne diffusent que ça. Le big-beat est venu secouer cette routine, a ouvert les esprits. Je suis fier que cette musique ait été nommée d’après notre propre club, la Big Beat Boutique. J’étais là le jour où mon copain Gareth a trouvé le nom. Récemment, je lui disais : “Imagine être là le jour où fut prononcé pour la première fois le mot reggae”… A chaque fois que je vois ce mot, “big-beat”, imprimé, je repense à ce jour où nous avons trouvé le nom du club. Un peu comme la house doit son nom au club Warehouse de Chicago, ou le garage au Paradise Garage…
Ce son est-il parfois une prison pour toi ?
C’est une prison pour Fatboy Slim, qui ne s’en sortira pas. Heureusement, j’ai d’autres noms pour enregistrer des disques. Et c’est vrai que, parfois, le son qu’on attend de moi m’ennuie, je m’y sens à l’étroit. L’idée de base du big-beat, c’était pourtant de s’autoriser tous les sons, tous les mélanges. Le seul lien entre les disques que nous passions de Madonna à des vieux ska , c’était le beat, qui devait être énorme.
Ton nouvel album You’ve come a long way, baby était très attendu. Comment as-tu géré cette pression ?
Je ne suis pas allé aussi loin que j’aurais voulu, je me suis parfois retenu. Pour la première fois, j’ai enregistré un disque en sachant que beaucoup de gens allaient l’écouter. Le succès de Rockafeller skank m’a fait un peu paniquer et j’en suis presque arrivé à souhaiter un flop du disque, que je retrouve ma tranquillité.
Dans ton set, une boucle affirme “I’ve never worked in my life” “Je n’ai jamais travaillé de ma vie”. Enregistrer est-il devenu un travail ?
Je n’ai travaillé qu’une fois dans ma vie, pendant un an, et c’était dans un magasin de disques de Brighton. Enregistrer, c’est une joie, jamais une corvée. La seule fois où j’ai l’impression de bosser, de m’ennuyer, c’est quand je suis forcé de donner des interviews ou de faire des vidéos. Mon truc, c’est d’être dans mon studio, d’y jouer le Professeur Maboul avec mes gadgets. En ce sens, je me sens plus proche de George Clinton ou Adrian Sherwood que d’une pop-star. Mais je sais que je suis encore trop timoré, il devrait y avoir des tubes à essais partout dans mon studio. Pourtant, je suis incapable d’écouter un disque sans immédiatement sortir mon scalpel et la table de dissection. Je suis même incapable d’apprécier un disque de dance-music. C’est pour ça que j’ai besoin d’écouter du blues ou Radiohead : c’est presque des vacances pour moi, loin de mes bases.
Un de tes groupes s’appelle Freakpower. Qui sont les freaks et ont-ils le pouvoir
Quand j’ai formé le groupe, tout le monde se moquait de moi parce que nous tentions de monter un groupe pop à 30 ans passés. Et tout ce qu’on avait à répondre, c’est qu’on était incapables de faire autre chose, qu’on était incapables de se lever le matin pour enfiler un costume, qu’on était totalement assistés à force d’être entourés de managers. Je ne savais même plus prendre le train tout seul, je me sentais totalement inadapté. Mais nous avions notre petit truc à nous, cette agilité dérisoire : nous savions écrire des chansons pop. En cas d’explosion nucléaire, je serais la personne la plus inutile sur terre. Nous ne sommes pas armés pour la vraie vie.
Quand on survole ta carrière, il semble que chaque nouveau groupe ou patronyme soit, pour toi, un moyen de retrouver la tranquillité après un triomphe inattendu. Mais à chaque fois, la gloire te rattrape.
Je n’ai pas envie que les gens pensent “Oh non, pas lui encore”, alors je change de masque. Ça me gêne beaucoup que les gens me comparent au roi Midas, que l’on croie que je change en or tout ce que je touche. Beaucoup de choses restent à l’état de boue. On ne voit que les quelques tubes que j’ai signés alors qu’il y a des merdes honteuses dans ma discographie. Aujourd’hui, c’est vrai que j’aime jouer avec mes masques. Car rien ne me serait plus insupportable que de devenir un personnage public, qu’on m’aime parce qu’on m’a vu à la télé. J’ai toujours préféré être en arrière-plan, le musicien invisible.
T’arrive-t-il de te perdre entre tes différentes identités ?
Je ne me perds jamais car aucun de ces personnages n’est vraiment moi, je les regarde de loin. Ce n’est qu’un nom écrit sur une pochette de disque, une tricherie… Quand j’enregistre ma musique, je ne sais jamais à l’avance qui sortira le disque, si ce sera Fatboy Slim, Mighty Dubkatz ou Freakpower… Quand je m’ennuie d’un d’entre eux, je vais rendre visite à l’autre.
Mais y a-t-il un véritable toi ? On dit à Brighton que ton vrai nom n’est même pas Norman Cook, mais Quentin Cook, que tu aurais pris ce prénom pour faire moins middle-class…
(Estomaqué)… Je suis devenu Norman Cook, j’ai obtenu le droit de changer ce prénom idiot après vingt ans de persécutions. Je détestais ce prénom, que personne ne savait épeler, dont nul ne se souvenait et dont tout le monde se moquait. Les gens pensaient systématiquement à Quentin Crisp (célèbre homosexuel anglais, réputé pour son humour et sa flamboyance) et éclataient de rire. A l’école, j’étais en permanence dans le collimateur. Plus tard, quand j’ai changé, on m’a accusé de dissimuler des origines soi-disant bourgeoises, alors que je n’aspirais qu’à une chose : ne plus être montré du doigt.
Ces dernières années, tu es devenu l’un des remixeurs les plus recherchés de la planète. Est-ce un autre de tes personnages qui se charge de ce travail ?
Comme avec mes propres morceaux, j’écoute des tonnes de bruits avant d’en trouver un qui me plaît et qui fera danser et sourire les gens. Ensuite, c’est un simple travail de mixage. Mais depuis quelques mois, je n’accepte plus rien. Je n’ai pas envie d’être le médecin miracle. Je ne suis pas un plombier qui débarque pour les urgences, qui remixe quand il y a une fuite dans la chanson. J’ai même refusé de travailler avec Madonna, je ne voyais pas ce que je pouvais lui apporter. C’est désormais mon seul critère pour choisir un remix : être capable de faire plus qu’une simple version du morceau, réaliser quelque chose qui m’appartienne, dont je suis fier.
As-tu l’impression qu’on cherche à acheter ta crédibilité ?
Tous les jours, je reçois des offres colossales. Et des fois, je me suis fait avoir, je me suis rendu compte que ces artistes ne recherchaient qu’une chose : mettre mon nom sur leur pochette. Il y a quelques années, j’étais beaucoup plus compétitif, je cherchais à me mesurer aux autres, je prenais tout ce qu’on me proposait. Puis j’ai traversé une profonde dépression nerveuse et du jour au lendemain je me suis débarrassé de ma compétitivité. C’est ma copine qui m’a guéri, en réussissant à me convaincre qu’être moi-même, ce n’était déjà pas si mal, que je n’avais pas besoin d’être numéro un dans les charts pour être un type bien. Le vrai succès pour moi, aujourd’hui, c’est de ne plus faire souffrir les gens. J’étais invivable, je voulais être reconnu à tout prix alors que pour la presse je n’étais qu’un has-been, une brêle. Aujourd’hui, il ne me reste qu’une ambition de mes années mégalo : entendre un de mes morceaux repris à la flûte de Pan dans un ascenseur. Et pour mon malheur, c’est le jour où j’ai décidé de ne plus rechercher le succès qu’il m’est tombé dessus (rires)…
Dans les clubs anglais, il y a souvent des affrontements entre les DJ de l’écurie Skint, ceux du label Wall Of Sound et ceux du club Heavenly. Ce qui frappe est la solidarité, le côté match amical de ces rencontres, loin des rivalités du rock.
Depuis le début, nous nous échangeons des disques, des tuyaux… Les Chemical Brothers, Death In Vegas, Monkey Mafia et moi, c’était un gang, nous nous retrouvions chaque week-end, souvent à la Big Beat Boutique. Cet endroit, c’est sacré pour moi. Je suis DJ depuis vingt ans et c’est le meilleur public que je connaisse. J’y suis chez moi, ce sont mes amis, ma famille… Pour un nouveau venu, l’ambiance de la Boutique peut être stupéfiante : c’est à la fois sauvage et très drôle. Pendant des années, les journaux de dance-music n’ont pas osé s’y aventurer, ils écrivaient que c’était un truc de mecs en sueur, de furieux… Alors que partout où je regardais, je ne voyais que des filles en soutien-gorge, hystériques une chose inconcevable dans un club hip-hop, techno ou même house, très mâles… Les filles me disent qu’elles aiment la Boutique parce que notre musique est joyeuse, entraînante, que c’est le seul club où elles ne se font pas draguer lourdement… Nous ne sommes pas des hooligans, je ne bois même pas de bière. Tout a changé il y a un an, quand un journaliste de Muzik qui, comme les autres, nous avait toujours snobés a échoué à la Boutique. Il en est ressorti secoué, il a écrit qu’il se passait quelque chose d’étrange et d’insensé à Brighton. J’adore cette ville, sa tolérance, son style et sa tranquillité.
Nous sommes ici dans un autre lieu historique de Brighton : ta House of Love, là où est née l’idée même de la Boutique.
Pendant deux ans, c’était notre petit monde, notre famille mais, peu à peu, tout le monde était au courant en ville, j’ai fini par arrêter. Nous avons failli avoir un coup dur une nuit : deux mecs défoncés sont allés dans le jardin et ne se sont pas rendu compte qu’une voie ferrée passait derrière ma haie. Ils se sont pris une énorme décharge électrique, un des deux a failli y passer, il avait les cheveux tout droits sur la tête, des brûlures partout.
On raconte qu’il y a eu une cordée organisée entre le sous-sol et ta chambre…
Nous étions tellement défoncés à la ketamine que je ne me souviens plus qui à part un des Chemical Brothers faisait partie de la cordée. Nous avons cherché toutes les ceintures de robes de chambre de la maison, nous nous sommes attachés les uns aux autres et sommes partis pour escalader l’Everest. Il nous a fallu des heures pour en trouver le point culminant : le haut de mon armoire, sur laquelle nous avons grimpé pour planter un drapeau (rires)… Nous y croyions dur comme fer.
On dit que, pour cette génération, tu as été un gourou, grâce à ton immense discothèque.
Le vrai gourou, c’était ma copine, qui faisait des massages à tout le monde, qui accueillait les étrangers à bras ouverts. Moi, je me contentais de l’éducation musicale. Les platines étaient ouvertes à tous, chacun pouvait aller piocher dans mes disques, à condition de ne pas toucher à mon ordre alphabétique… J’avais mis un panneau au-dessus des platines : “No boring house-music tonight”… Dès que l’ambiance retombait, on changeait de DJ : ça nous condamnait au surpassement… D’Elvis Presley à la techno hardcore en passant par les Carpenters, tous mes disques s’enchaînaient, tout était autorisé du moment qu’on s’amusait l’esprit de base de la Big Beat Boutique.
Quelqu’un avait-il rempli pour toi ce rôle d’éducateur ?
Je dois tout à John Peel, dont j’écoutais les émissions tous les soirs à la radio quand j’étais gosse. C’est grâce à lui si j’aime le dub, le reggae, le blues, qu’il enchaînait avec des disques punks ou de musique industrielle.
La révélation, ensuite, ça a été Grandmaster Flash, cet art du collage… C’est là que je suis devenu DJ, car j’étais celui qui possédait le plus de disques. Mais très vite ils ont été souillés par le vomi, la bière… Je me suis rendu compte que je pouvais faire danser les gens, que j’adorais être derrière les platines. C’était, en plus, une bonne justification pour mon obsession : acheter des disques. Regarde… (Il sort des disques au hasard de sa collection : chaque titre est annoté, flanqué de son bpm et d’indications pour d’éventuels samples)… C’est une véritable maladie, pire que chez Nick Hornby. Mais je reste sélectif : il n’y a pas un disque de heavy-metal, presque pas de rock, pas de country contemporaine, pas de gangsta-rap, pas de R’n’B… J’ai toujours eu un problème avec les guitares électriques jouées par des types à cheveux longs.
Que cherchais-tu dans ces disques que tu achetais frénétiquement ?
Très tôt, les disques ont été ma famille : à la fois ma maîtresse, mon père, mes frères. Mes parents m’ont dit récemment qu’à 3 ans la musique était déjà ma seule passion. Plus tard, j’ai acheté mon premier magnéto à cassette, qui m’a permis de passer à la vitesse supérieure : au lieu de me contenter d’acheter et d’écouter des disques, je pouvais désormais les déformer, les mettre bout à bout, expérimenter. La musique m’a donné tous les plaisirs possibles à part un orgasme, et encore. Quand je suis triste, déprimé, je monte ici, dans ma discothèque, et je ressors systématiquement réjoui. C’était déjà le cas avec les disques de mes parents, les Beatles, les Carpenters… Nous habitions en pleine banlieue pavillonnaire c’est-à-dire en enfer. Un endroit où tout le monde se casse à 18 ans avant de revenir y élever paisiblement ses enfants à 35 ans… Si bien que cette tranche d’âge entre les deux n’existait pas. J’étais horriblement frustré dans cet endroit où il ne se passait jamais rien, où tout le monde me montrait du doigt car j’étais, depuis mes 14 ans, le seul punk. Je me faisais tabasser en permanence, je n’étais nulle part à ma place. Mon seul copain était un petit mod, Paul Heaton, qui est ensuite devenu le chanteur des Housemartins et du Beautiful South. Tous les deux, on faisait la manche en ville sous le nom de Stomping Punk Frogs, on était sans arrêt épinglés par les flics. Plus tard, quand certains copains ont pu conduire, on se donnait rendez-vous sur le parking d’un salon de beauté, on disposait les voitures en cercle, tous phares allumés et on jouait au centre. Sans doute les premières raves de l’histoire (rires)… Notre groupe était l’esquisse de ce qui allait devenir les Housemartins.
Pour beaucoup de gens, tu es encore “l’ancien bassiste des Housemartins”. Ça lasse ?
C’est épuisant, ça fait pourtant plus de dix ans que tout cela est fini… Si les gens sont surpris aujourd’hui que l’ancien bassiste des Housemartins fasse ce genre de musique, ce n’est rien comparé à la réaction de mes copains d’alors : “Qu’est-ce que tu fous avec les Housemartins ? On sait que tu n’écoutes que du rap et de la soul.” Ma seule ambition, avec eux, était de ressembler à Paul Simonon, le bassiste de Clash. Je pensais que c’était une façon de rentrer dans le rang, d’être accepté. Jusqu’à l’invention du sampler, je ne voyais pas comment jouer la musique que j’aimais sans faire semblant d’être noir. Après tout, je n’avais pas le droit de jouer du rap, j’étais un petit Blanc de la banlieue de Crawley et les seuls groupes du coin s’appelaient Cure ou Damned pas Public Enemy. C’est quand des groupes comme Coldcut d’anciens collègues DJ ont émergé que je me suis dit que je jouais un rôle dans les Housemartins qui ne me ressemblait pas. Car cette musique, c’est ce que je faisais en cachette chez moi depuis des années, sans le moindre intérêt des labels. Pump up the volume de MARRS a tué les Housemartins.
T’es-tu immédiatement investi dans cette musique, dès le Summer of love de 88 ?
Je suis passé à côté, car je vivais encore à Hull, au nord-est du pays, avec les Housemartins. Et il ne se passait rien là-bas, le Summer of love n’y a débarqué qu’en 94… Je ne suis revenu à Brighton qu’à l’hiver 88, après le split du groupe, et j’ai retrouvé tous mes copains avec des T-shirts Smiley et des bandanas… J’avais l’impression de débarquer sur Mars, personne ne me voulait comme DJ, car je ne passais pas d’acid-house ou de house à piano italienne… Je ne pouvais décemment pas danser là-dessus. C’est avec trois ans de retard que j’ai trouvé ma clé d’entrée dans la house, grâce à des morceaux de reggae passés par le DJ d’Underworld.
Outre le reggae, les drogues t’ont-elles aidé à comprendre la house ?
L’ecstasy a beaucoup aidé à forcer la porte. D’où les titres de mes disques de l’époque : le premier Freakpower devait être baptisé Just say yes la maison de disques a refusé et le premier Fatboy Slim s’appelle Better living through chemistry (“Vivez mieux grâce à la chimie”)… Disons que j’ai vécu quelques années assez riches et stimulantes. C’était ce qui rendait la House of Love si conviviale : tout le monde prenait de l’ecstasy, on passait notre temps à s’embrasser, à se câliner, à se masser. Le simple fait de regarder un seau d’eau devenait une expérience extraordinaire, tout le monde en hurlait de bonheur (rires)… C’était la première fois que j’aimais les gens, que j’appréciais leur compagnie, que je leur parlais autant. C’était une telle métamorphose pour moi que je suis devenu très évangéliste au sujet de l’ecstasy.
Cette boulimie de drogue a-t-elle fini par devenir dangereuse pour toi ?
Oui. Après l’accident sur les voies ferrées, j’ai arrêté de prendre de l’acide. Mais même si je vois les dangers évidents de la drogue, elle m’a permis de devenir sociable, alors que j’étais arrogant et désagréable.
Es-tu désormais moins maniaque, plus relâché au travail également ?
Malheureusement, non. Quand je suis tout seul à la maison, je peux passer trente-six heures dans mon studio sans même m’en rendre compte, oublier de manger pendant deux jours. Les gens ont l’impression que je suis dilettante, mais mes disques demandent un travail de dingue. Je peux passer une nuit entière sur un son. Ma copine me dit qu’elle sait quand j’ai trouvé la solution à une chanson car, de la cuisine, elle m’entend taper du pied (rires)… Cette pièce, c’est mon univers : mes petites mascottes, mes flyers, mes photos et mes disques. Mais cette pièce a totalement détruit mon mariage. Je passais plus de nuits ici que dans le lit conjugal. Ça, c’était l’ancien moi, qui crevait d’ambition, qui acceptait toutes les propositions de remix avec avidité. Le nouveau moi, il n’a rien contre passer une nuit au lit avec sa copine.
Fatboy Slim, You’ve come a long way, baby (Skint/Small/Sony).




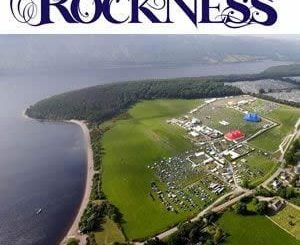


Be the first to comment